La prise de la Bastille en 1789, bien sûr ! C’est ce que nous avons tous appris à l’école. Mais derrière cette leçon se cache une histoire plus nuancée – et parfois bien différente de l’image d’Épinal que l’on en a …
1. Pourquoi la Bastille ?
Cette prison d’État, encadrée par huit tours massives et implantée en plein coeur de Paris, est avant tout un symbole, celui du despotisme royal. On y enferme les ennemis du roi, les opposants à la monarchie, sur simple lettre de cachet. On ne sait pas toujours pourquoi on y entre. Ce bâtiment, qui alimente tous les fantasmes, fait peur, et c’est pourquoi, en cette fin de siècle troublée, il devient la cible idéale d’un peuple en colère.
2. Une prison si terrible ?

Tout dépend du rang des prisonniers. Les plus fortunés peuvent y vivre relativement confortablement. Ils sont convenablement nourris, peuvent faire venir leurs meubles, leurs domestiques, recevoir des visites et du courrier… En revanche, les moins chanceux n’échappent pas aux cachots humides et aux maigres repas. Cela dit, pour l’époque et contre toute attente, le régime carcéral de la Bastille est plutôt moins sévère qu’ailleurs.
3. Le 14 juillet 1789 : assaut ou malentendu ?

La tension monte à Paris : le 11 juillet, le ministre Necker, très populaire, est renvoyé par Louis XVI, au moment même où les troupes du roi encerclent la capitale. Le 14 juillet, le peuple, persuadé qu’un coup de force royal se prépare, s’empare d’armes entreposées aux Invalides, puis marche vers la Bastille, qui abrite des réserves de poudre. Le gouverneur, le marquis de Launay, tente de négocier, mais la situation vire au chaos à la suite d’une série de malentendus, entraînant l’assaut de la Bastille, qui s’est davantage rendue qu’elle n’a été prise. La tête du malheureux de Launay, finalement lynché par les insurgés, est triomphalement brandie au bout d’une pique. L’événement est sanglant, certes, mais aussi largement symbolique.
4. Et les prisonniers dans tout ça ?
Si d’illustres personnages, tels que Montaigne, Nicolas Fouquet, l’homme au masque de fer, Voltaire ou encore le marquis de Sade, avaient jadis été enfermés dans les geôles de la Bastille, le constat en ce 14 juillet est des plus décevants. Seuls sept prisonniers sont retrouvés ; parmi ceux-ci, des fous, des faussaires et un jeune libertin… Afin d’alimenter le mythe, on inventa un prisonnier romanesque, le comte de Lorges, vieillard barbu et aveugle, écroué depuis trente-deux ans.
5. Qu’en est-il de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 ?
Sur le Champ-de-Mars, on célèbre l’unité retrouvée autour de la nation (dont elle signe l’acte de naissance), de la loi et du roi. Celui-ci prête serment sur la nouvelle constitution devant une assistance en liesse. L’esprit révolutionnaire est encore teinté d’espoir et de conciliation, mais cela ne va pas durer !
6. Quand le 14-Juillet est-il devenu la fête nationale ?
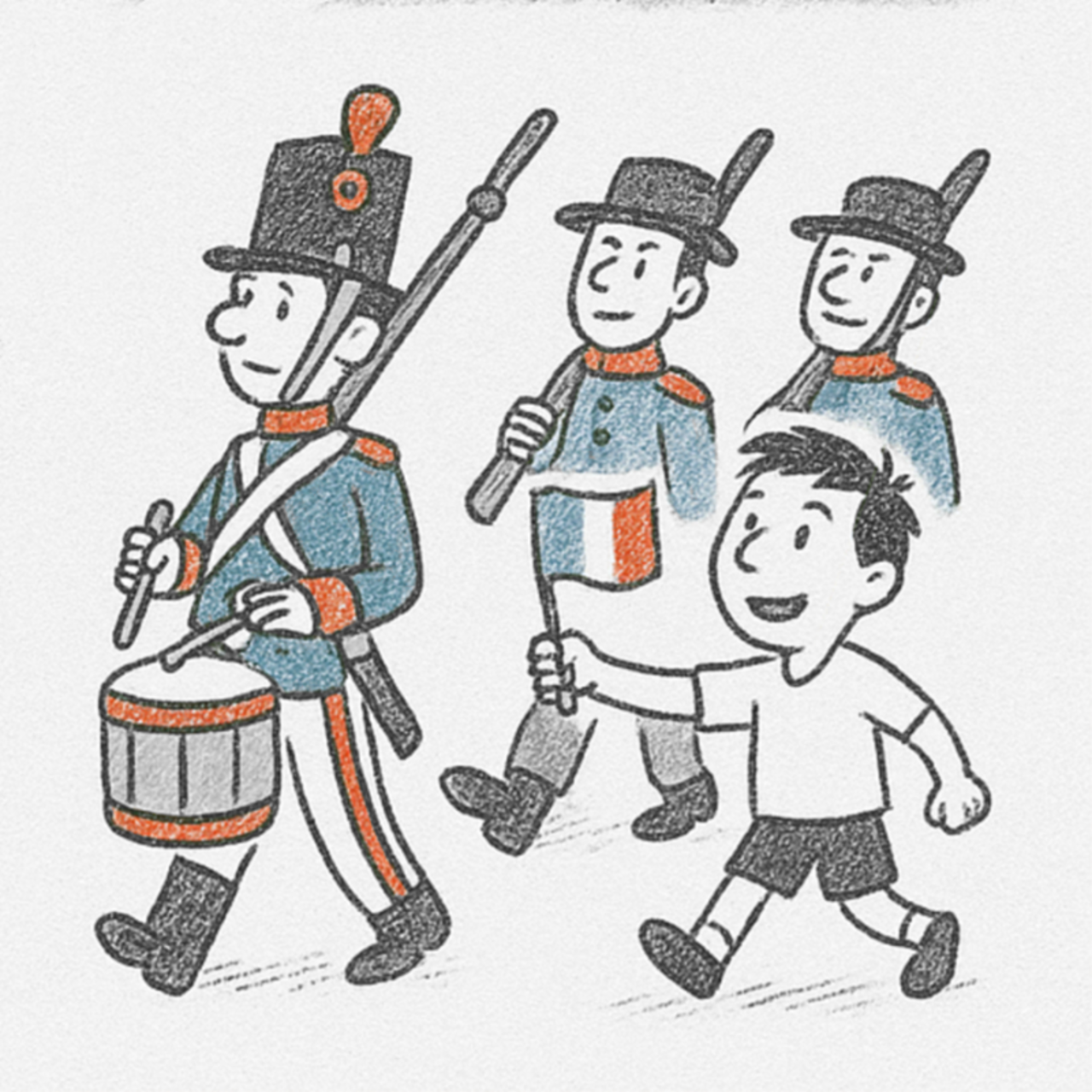
Après la fête de la Fédération, il faut attendre près de cent ans pour que le 14-Juillet soit officiellement reconnu comme fête nationale. Encore aujourd’hui, nous ne savons pas si nous célébrons la prise de la Bastille de 1789 ou la fête de la Fédération de 1790, la loi de 1880 restant volontairement floue afin de préserver le consensus au sein d’un Parlement dominé par les républicains, mais divisé quant à l’héritage révolutionnaire et sa symbolique. Depuis, chaque année, on défile, on danse, on tire des feux d’artifice, en oubliant un peu que notre fête nationale trouve son origine dans l’un des épisodes les plus « tranchants » de l’histoire française.
Le 14 juillet, entre traditions militaires et festivités populaires

• Le défilé militaire : dès 1880, l’armée est mise à l’honneur sur l’hippodrome de Longchamp, illustration du redressement de la France après sa défaite humiliante contre la Prusse. Depuis 1919, les soldats sont invités à parader sur les Champs-Élysées, sauf exception. En 2024 notamment, le défilé se déroule sur l’avenue Foch, en raison des Jeux olympiques.
• Le feu d’artifice : divertissement réservé à l’aristocratie entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, le feu d’artifice se démocratise au XIXe siècle, devenant un spectacle populaire, festif et patriotique, hérité de l’esprit de la fête de la Fédération. Aujourd’hui, il est l’un des moments les plus attendus de la soirée du 13 ou du 14 juillet.
• La retraite au flambeau : cette procession nocturne aux lampions, inspirée des cortèges révolutionnaires lors de la prise de la Bastille, fait partie du folklore festif. À Courbevoie, elle ne sera pas organisée cette année, pour des raisons sécuritaires et écologiques.
• Le bal des pompiers : cette tradition conviviale remonterait à l’époque napoléonienne, mais c’est dans les années 1930 qu’elle aurait pris la forme que l’on connaît : des casernes ouvrant leurs portes aux habitants après le défilé, dans une ambiance festive et bon enfant.
• L’interview télévisée du président de la République : c’est en 1978, sous Valéry Giscard d’Estaing, que cette prise de parole présidentielle devient une sorte de rendez-vous avec les Français. À quelques exceptions près, tous les présidents s’y sont pliés. Enfin, l’une des deux promotions civiles annuelles dans l’ordre national de la Légion d’honneur est annoncée le 14 juillet, qui fut également l’occasion d’une grâce présidentielle collective de 1991 à 2007.

